

Les machines s’émancipent
« Après l’ère des machines en agriculture, puis l’ère des produits de synthèse en protection des cultures, nous arrivons dans l’ère des robots », a présenté Florent Banctel, conseiller viticole et ingénieur Réseau Ferme DEPHY à la Chambre d’Agriculture des Pays-de-la-Loire, lors de l’Assemblée générale de Terra Vitis Loire, organisée le 4 avril dernier au Domaine Cogné, à Saint Christophe La Couperie (Maine-et-Loire).
« La première raison au développement des robots est de palier les interdictions à venir sur les herbicides, avec du travail du sol régulier contre les adventices. Dans un second temps, les robots devront être capables de réaliser du rognage, de l’épamprage et de l’effeuillage, mais aussi de la pulvérisation. ». Oz, petit robot agricole précurseur conçu par l’entreprise Naïo Technologie, bien que testé dans les vignes, reste uniquement adapté au maraîchage, avec une puissance trop faible pour les sols viticoles, observe Florent Banctel. Son grand frère, Ted, semble plus prometteur pour le travail interceps. « Actuellement, trois sociétés font la course en tête : Naïo sur le Sud-Ouest avec l’IFV du Sud-Ouest comme partenaire et le robot Ted, Vitibot en Champagne avec l’appui du CIVC et le robot Bakus adapté aux pentes à 45%, et Sitia sur le Nantais avec la CaPdL et le soutien de la région, et le robot PumAgri. En parallèle, la société Vitirover développe ses robots tondeurs, et le consortium européen VineScout met au point un robot pour fin 2019, davantage orienté sur la prise de mesures et du repérage. »
Au point d’ici 3 ans
Pour le moment, si plusieurs robots tournent dans les vignes, ils correspondent davantage à des préséries vendues à moindre frais à des vignerons afin d’ajuster les réglages en vue d’une commercialisation dans quelques années, observe Florent Banctel. C’est le cas du robot acheté par le domaine Malidain dans le nantais, qui a acquis un robot Ted pour entretenir 15 des 45ha de l’exploitation. « D’ici 3 ans, les robots seront au point ! assure Florent Banctel. Mais avant, les premiers acheteurs auront essuyé les plâtres. ». Pour le moment, les robots ont encore besoin d’assistance et de surveillance. « Le robot reste un outil. La gestion des déplacements et des tâches à suivre nécessite la présence d’un opérateur. Les robots ne seront pas forcément efficient dans tous les systèmes en fonction du parcellaire, des formes de ceps et ne conviendront pas à tous les vignerons selon l’affinité avec ces nouveaux outils ! », note le conseiller. Côté prix, si Naïo évoque 150 000 euros pour Ted, Vitibot indique un tarif « équivalent à un enjambeur neuf » pour son Bakus. Sitia reste pour sa part plus discrète pour le moment…
Consultez aussi Tous les articles


Lutte contre le gel de printemps
Des risques de gel sont attendus dans les prochaines nuit ; les vignerons sont déjà sur le qui-vive depuis la nuit du 3 au 4 avril. Dans ce contexte, la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire a publié en page 3 de son dernier bulletin technique une synthèse sur les éléments à prendre en compte dans la lutte contre le gel : l'optimisation de ses moyens de lutte contre le gel de printemps, les données de mesures pour déterminer les risques de gelées, les quelques précautions à prendre en cas de feu de paille.
Pour en savoir plus sur les équipements de protection du vignoble contre le gel du printemps
Consultez aussi Tous les articles


S’y retrouver dans les stations météo connectées
De plus en plus de vignerons s’équipent en station météo connectée. Seuls ou en groupe, contre le gel ou pour mieux positionner ses traitements, avec du haut de gamme ou des premiers prix… Anastasia Rocque de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire et Guillaume Gastaldi de l’ATV49 font le point pour s’y retrouver !
Les stations météo connectées se développent dans le vignoble de Touraine depuis 2018, surtout pour la problématique gel, observe Anastasia Rocque, conseillère à la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire. « 80% des vignerons équipés, le sont en stations Sencrop, entreprise très présente commercialement sur le secteur, et les 20% restants sont équipés en stations d’autres marques comme Weenat, Météus... ». Pour le groupe 30 000 Ecophyto de Bouillé-Loretz (Deux-Sèvres, sud Layon) composé de 13 vignerons suivis par l’ATV49 et la Chambre d’agriculture Pays de Loire, huit stations météo Promété, ont été installées en 2018 sur les 500 ha du groupe, pour réaliser le suivi du risque mildiou et avoir une mesure précise des précipitations. Guillaume Gastaldi, l’animateur du groupe, précise : « Ce réseau est complémentaire de notre réseau traditionnel Demeter que nous utilisons pour notre bulletin de préconisation avec la modélisation IFV Epicure. Le choix s’est orienté sur du matériel Promété, après comparaison par les vignerons des offres de quatre prestataires : Weenat, Sencrop, Newfarm-Agriconsult et Promété. »
Une formation sur les stations
Mais comment faire le bon choix de station ? Pour aider les producteurs, la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire propose une formation intitulée "équiper son vignoble d’une station météo connectée". La prochaine aura lieu le lundi 25 mars 2019 à Parçay-Meslay. « Pour avoir des données géolocalisées de pluviométrie dans sa lutte phyto, un réseau de pluviomètres connectés est intéressant. Des stations météos connectées complètes, comme celles de Sencrop ou Weenat autour de 500 euros avec abonnement, apportent également des jeux de données de températures ambiantes et de pluviométrie suffisants, en comparaison à des stations plus performantes et chères.... détaille Anastasia Rocque. Pour la prédiction sur le gel, les stations météo connectées sont plus précises et proposent des données plus complètes, notamment la température humide. Cette dernière est soit effectivement mesurée sur les stations haut de gamme, soit calculée avec légèrement moins de précision. L’enjeu peut être alors d’investir dans une station performante en groupe, puis de disposer de pluviomètres connectés sur les différents domaines. Il est aussi important de connaître les écarts entre sa station et le reste du vignoble pour lancer les outils de lutte antigel. ». Avec les mesures de pluviométrie, température, hygrométrie et l’humectation du feuillage, la station Promété permet d’affiner la prédiction mildiou, indique Guillaume Gastaldi. Les données sont « expertisées », c’est-à-dire comparées aux données déjà enregistrées sur la zone, afin d’avoir les prévisions les plus fiables possible. « Le choix du fournisseur n’aurait pas été le même si les vignerons avaient souhaité suivre uniquement le risque de gel. D’un fournisseur à l’autre, vous avez des différences en termes de réactivité par exemple », précise le conseiller. Le groupe 30 000 des Deux-Sèvres a fait le choix d’une unique station météo Promété à 2 000 euros, complétée par sept pluviomètres connectés avec capteurs d’humectation du feuillage (580 euros chacun), avec une mise en réseau de l’ensemble des données pour les vignerons du groupe. « La station Promété est plus chère, mais a paru plus robuste aux vignerons et avait l’avantage d’être reliée avec de la modélisation. Une visite technique de l’équipe Promété a lieu une fois par an, pour assurer la maintenance complète du réseau de station. »
Un coût vite rentabilisé ?
Au final, l’investissement de base de 8 600 euros pour le groupe 30 000 a été financé à 60% par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (programme Ecophyto), et 40% par le collectif des vignerons. Chaque vigneron paye annuellement 100 euros de maintenance et de coût de télécommunication et s’il le souhaite souscrit au modèle mildiou Promété pour 150 euros. « Ce coût est vite rentabilisé. C’est sur les traitements en début et fin de campagne que les économies permises par la modélisation sont les plus importantes. À ce tarif, une simple modulation de dose permet d’amortir l’investissement », poursuit le conseiller. Après avoir opté pour l’achat de stations et pluviomètres connectés, l’enjeu sera de bien les positionner, en les mettant le plus souvent dans les zones les plus à risque pour le gel, afin d’anticiper les dégâts. La Chambre d’agriculture d'Indre-et-Loire aide aussi les vignerons à positionner au mieux leurs outils de mesure, précise Anastasia Rocque.
Des améliorations encore possibles
Parmi les points d’amélioration, Guillaume Gastaldi note la rapidité de transmission des différentes données, qui devrait à terme être instantanée. « Sur la rapidité de transmission des données, un travail semble fait par les constructeurs, évoque pour sa part Anastasia Rocque, mais il reste un vrai problème de non-harmonisation des données entre stations météos. Nous aimerions pouvoir suivre sur un portail l’ensemble des données des différentes stations météo du vignoble, mais aucune plateforme ne permet de consulter l’ensemble de ces données pour le moment. ». En conclusion, investir dans une station météo associée à un modèle vaut le coût pour Guillaume Gastaldi, « surtout en groupe où cet investissement s’accompagne d’une démarche de progrès pour l’exploitation grâce aux échanges techniques entre vignerons et l’accompagnement par un conseiller indépendant. Dans le cadre du groupe, nous suivons des témoins non traités pour valider année après année la pertinence du modèle utilisé et des réunions téléphoniques hebdomadaires en saison permettent de fiabiliser l’analyse du modèle et sécuriser les prises de risque des vignerons ».
Consultez aussi Tous les articles


La bataille des robots viticoles est lancée ?
Bakus du champenois Vitibot, Ted de la startup toulousaine Naïo Technologies, Pumagri de la société nantaise Sitia et enfin les robots tondeurs de Vitirover basée à Saint-Emilion. Pour comparer les solutions robotisées dédiées à la viticulture, une conférence était organisée par l’IFV au Vinitech 2018.
Faible consommation d’énergie, tassements de sol réduits, polyvalence, déplacement à vitesse maîtrisée avec des capteurs pour éviter les blessures sur les ceps, travail à toutes heures du jour et de la nuit, relevé de données sur la vigne (manquants, maladies, etc.)….., les robots autonomes ont su créer beaucoup d’attentes chez les vignerons ces derniers temps. Si les premières préséries sont à l’œuvre dans les vignes, les phases de commercialisation chez les divers constructeurs sont plutôt prévues pour 2020-2021. Avec son « troupeau de robots tondeurs industriels et autonomes », Vitirover basée à Saint-Emilion veut s’imposer dans l’après glyphosate, souligne Arnaud de la Fouchardière, directeur général de l’entreprise : « Nous ne vendons pas nos robots mais des surfaces entretenues ! » En effet, la société propose en prestation l’entretien de l’enherbement des vignes par une flotte de robots supervisée par un « berger », salarié de Vitirover, qui se chargera de déplacer les robots et d’en assurer la maintenance. « Avec un couvert permanent de 4 à 6 cm, les racines herbacées vont peu en profondeur, et ne sont pas concurrentes de la vigne », insiste Arnaud de la Fouchardière. Déjà une cinquantaine de robots de 20 kg avançant à 200 m/h sont sortis d’usine, bientôt suivis d’une cinquantaine supplémentaire, et 200 à 1000 devraient ensuite être construits dans les mois/années à venir. Pour expliquer le coût de sa prestation, Vitirover évoque l’absence de pieds abimés par le travail du sol classique. La prestation revient à un coût annuel de1500 à 3500 euros/an/ha selon le schéma de la parcelle.
Ted et Bakus attirent les visiteurs
À quelques mètres l’un de l’autre dans les allées du Vinitech 2018, Ted et Bakus suscitaient la curiosité des visiteurs. Après le petit robot Oz puis Dino pour le maraîchage en planche, Naïo Technologies travaille sur les robots Jo (chenillard) et Ted (enjambeur) destinés aux vignerons. 100% électrique, fabriqué en France et se déplaçant par signal GPS et laser et avec 8h d’autonomie, Ted réalise du désherbage mécanique, mais aussi de la tonte, épamprage, rognage, et peut-être ensuite de la pulvérisation. « C’est un porteur qui est capable d’intégrer différents éléments. Nous échangeons avec les constructeurs de matériel afin d’adapter les outils à nos robots qui se déplacent moins rapidement qu’un tracteur », souligne Guillaume Delprat, responsable marché vigne chez Naïo, précisant qu’un robot peut gérer 15 ha en vignes étroites, et 40 ha en vignes larges. Une dizaine de robot Ted sont en expérimentation chez des clients. Plus lourd que Ted (800kg), l’enjambeur électrique monorang Bakus (2,1 t à vide) limite les tassements de sol, indiquent ses concepteurs. Avec des batteries lui offrant 10h d’autonomie, il est adapté aux terrains en pente jusqu’à 45% et avec un dévers jusqu’à 10%. « Bakus se déplace à l’aide de 8 caméras, ainsi qu’une intelligence artificielle à la différence de ses concurrents », souligne Cédric Bache, fondateur de la startup rémoise qui emploie désormais 40 personnes. Là aussi, le travail du sol est le premier objectif de Bakus, même si la pulvérisation confinée est à l’étude. « Beaucoup de vignerons pensent qu’un robot coûte cher, mais comparé à un tracteur traditionnel, nos robots sont moins onéreux et plus fiables, car ils ont moins d’actionneurs. Et les prix vont diminuer énormément dans les années à venir ! » Même constat chez Naïo : « L’hydraulique et les moteurs thermiques entraînent beaucoup de problèmes et nécessitent une maintenance régulière, alors qu’avec l’électrique, la maintenance est beaucoup moins coûteuse ! »
Groupe thermique et électrique pour Sitia
Plus discrète, la startup Nantais Sitia s’est lancée depuis 5 ans dans la robotique agricole, avec la mise au point d’un véhicule polyvalent, destiné au maraîchage, l’arboriculture et la viticulture : le Pumagri, présenté notamment au Sival 2018. À la différence de ses deux concurrents précédents, ce robot est équipé d’un moteur hybride, avec un groupe thermique qui recharge les batteries lorsqu’elles sont faibles. « Le robot peut ainsi tourner uniquement sur moteur électrique silencieux la nuit ou à proximité des habitations », précise Jérôme Petit, directeur technique Sitia. Là aussi, le travail du sol est ciblé en priorité, suivi d’essais en pulvérisation confinée fin 2019 et de l’entretien des plants (rognage). « Un robot pourra gérer 20 ha, sur l’ensemble de l’itinéraire technique », précise Jérôme Petit. Si une présérie a déjà été vendue à des partenaires pour une livraison en 2019, la commercialisation est prévue en 2020.
Changer le métier de viticulteur
L’arrivée des robots risque de changer le métier de viticulteur, « l’orientant davantage sur de la gestion logistique et de l’organisation de travail de ses robots » d’après Jérôme Petit. Autre évolution : une fréquence de passage plus élevée pour le travail du sol, tous les 15 jours, souligne Guillaume Delprat, qui est optimiste sur le temps de prise en main : « en seulement 2h, d’après notre expérience, et avec une formation de 4 demi-journées pour une maîtrise totale du robot. ». Les robots vont aussi permettre de nourrir des bases de données sur chaque pied de vigne, pour des itinéraires techniques un jour adaptés de façon individuel, projette Arnaud de la Fouchardière. Si des questions réglementaires se posent quant aux déplacements des robots sur la voie publique, Cédric Bache est convaincu que « les véhicules autonomes agricoles arriveront avant les voitures autonomes, car en avançant à 10 km/h maximum, nos robots sont capables de s’arrêter quasi instantanément, ce qui réduit très fortement les risques d’accident ! »
Consultez aussi Tous les articles


Témoignage : je choisis un robot pour biner !
C’est en mai que le vignoble Malidain, situé à 25 km au sud de Nantes dans le muscadet, recevra un robot enjambeur Ted, mis au point par la société toulousaine Naïo Technologies. Pour Romain Malidain, féru de nouvelles technologies, cette acquisition correspond à un besoin d’évolution des pratiques. Après avoir rencontré à plusieurs reprises Naïo Technologies, notamment lors du SIVAL autour du petit robot Oz en 2016, puis Ted en 2018, Romain Malidain a choisi de franchir le pas. « Cette entreprise est vraiment bien avancée sur le sujet, en particuliers dans le maraîchage, avec les robots les plus aboutis du marché selon moi. Avec les plantations en ligne par GPS pour les vignes, le binage mécanisé est de plus en plus précis. Notre parcellaire, composé de gros ilots, est aussi bien adapté pour le travail d’un robot. ».
« Depuis plusieurs années, nous cherchons à réduire le désherbage chimique. Avec le retrait progressif des produits phytos, il faut prendre les devants et développer le désherbage mécanique, que nous faisons intégralement sur près d’un quart du domaine depuis trois ans. Nous avons par ailleurs des difficultés à trouver de la main d’œuvre qualifiée pour conduire les engins spécifiques dans les vignes, d’où mon intérêt pour les robots autonomes. »
Biner les 45 ha du domaine d’ici 3 ans
Le robot enjambeur Ted devrait ainsi pouvoir gérer les 45 ha du domaine, d’ici trois ans. Car pour 2018, l’objectif est d’assurer les réglages pour désherber une quinzaine d’hectares. « Nous allons être suivis pendant deux ans par les équipes Naïo, pour une bonne mise en route. Le désherbage mécanique marche dans tous les types de sols, mais à condition de passer au bon stade. Et entre un sol caillouteux et un sol plus sablo-argileux, cela se joue parfois à deux jours ! ». L’objectif pour Ted au vignoble Malidain sera donc de réaliser le binage, et pourquoi pas la tonte et l’ébourgeonnage pas la suite. Pour la pulvérisation, Romain Malidain n’imagine pas forcément utiliser son robot, car « les drones devraient apporter surement des réponses plus efficaces sur ce sujet. ». Pour 2018, une dizaine de robots enjambeurs Ted vont être vendus en France, dont deux en Val-de-Loire. Le deuxième acquéreur n’est pas encore défini, évoque le vigneron. Malgré un prix proche des 100 000 euros, l’acquisition d’un robot Ted est un calcul rentable d’après Romain Malidain.
« En comparant à l’achat d’un tracteur, l’entretien, le gasoil et le coût du salarié, le coût de revient de Ted est plus intéressant, à condition d’avoir un parcellaire adapté, et sans espérer que le robot fasse tout ! Il faudra tout de même l’emmener sur les parcelles et le récupérer une fois le travail terminé. Ce sera un outil pour nous aider, avec un vrai intérêt écologique, dans lequel je crois beaucoup. La robotisation est un sujet d’avenir, et j’ai fait le choix de prendre les devants avec Ted ! »
Consultez aussi Tous les articles


Entretien du sol en vignes étroites
Dans le cadre du plan Ecophyto II, la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et l'Union des Cuma de Loire-Atlantique ont co-organisé une demi-journée sur l'entretien des sols en vignes étroites, en octobre dernier. Diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices, réglage du tracteur-enjambeur au travail du sol et démonstration de neuf outils étaient au programme de cet après-midi. Voici la synthèse de l’après-midi.
Consultez aussi Tous les articles


Gérer au mieux le travail du sol intercep
Pour répondre au plan Ecophyto 2 et afin d’anticiper sur une éventuelle réduction de l’offre herbicides à moyen terme, et d’avoir des informations pour de futurs investissements, le réseau de fermes de références Dephy de la Chambre d’agricul-ture d’Indre-et-Loire a organisé le 9 novembre 2017 une journée autour du travail sous le rang avec l’intervention de Perrine Dubois (ATV 49) sur les clés pour gérer au mieux l’entretien mécanique du cavaillon et une démonstration de matériel. Résumés des démonstrations.
Consultez aussi Tous les articles


Mesure d'oxygène dissous : choisir son outil portatif
La demande pour des outils portatifs de mesure d’oxygène dissous augmente d’année en année, surtout pour la période d’élevage. Le choix d’un équipement portera sur le niveau de précision souhaité, le coût de l’appareil et la facilité d’utilisation.
Mesurer l’oxygène dissous dans les vins tout au long de son élaboration n’est pas encore une pratique ancrée dans les mœurs mais pourrait le devenir. C’est en effet un bon révélateur des pratiques de travail dans les caves. Prendre conscience de l’impact de certaines opérations pratiquées machinalement peut faire changer simplement des méthodes de travail altérant significativement le profil des vins. De plus, la maîtrise de l’oxygène dissous est un point clé dans la réussite de la réduction des doses de SO2 puisque 1 mg/l d’O2 dissous combine autour de 4 mg/l de SO2 libre. Le suivi de l’oxygène dissous peut se faire par le vigneron lui-même grâce à un oxymètre ou il peut faire appel à un prestataire qui réalise un audit. À l’occasion de cet audit, des points de mesure sont réalisés aux étapes clés d’enrichissement possible d’oxygène dissous. Les principaux problèmes identifiés viennent des becs de tireuses, des pompages rapides et inappropriés. Ainsi, un rappel des bonnes pratiques peut prévenir de la dégradation des profils de vins souhaités. La mesure de l’oxygène dissous est également un précieux indicateur dans le suivi et la réalisation de la micro-oxygénation.
4 exemples d’équipement
L’utilisation d’un oxymètre est simple mais l’interprétation des résultats nécessite l’élaboration d’un historique de travail. On trouve dans la littérature des fourchettes de valeur de dioxygène qui peuvent se dissoudre à chaque opération. Il est nécessaire que le vigneron fasse des mesures pour se créer un historique, un référentiel et personnalise son mode opératoire. Les conditions de mesures doivent être répétables : avant ou après sulfitage… Pour chaque outil de mesure, un accompagnement ou une formation sont possibles par les firmes elle-même ou des œnologues conseils. Les outils de mesure de l’oxygène dissous et de l’oxygène dans l’espace de tête peuvent reposer sur des méthodes chimiques, électrochimiques (polarographique) ou par luminescence.
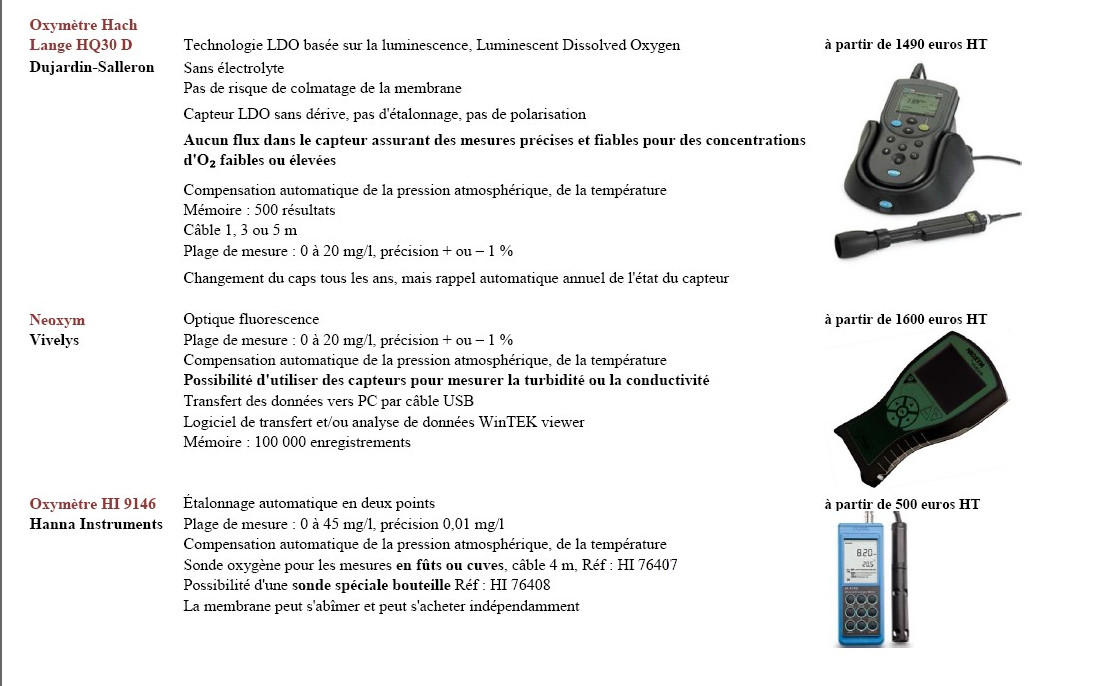
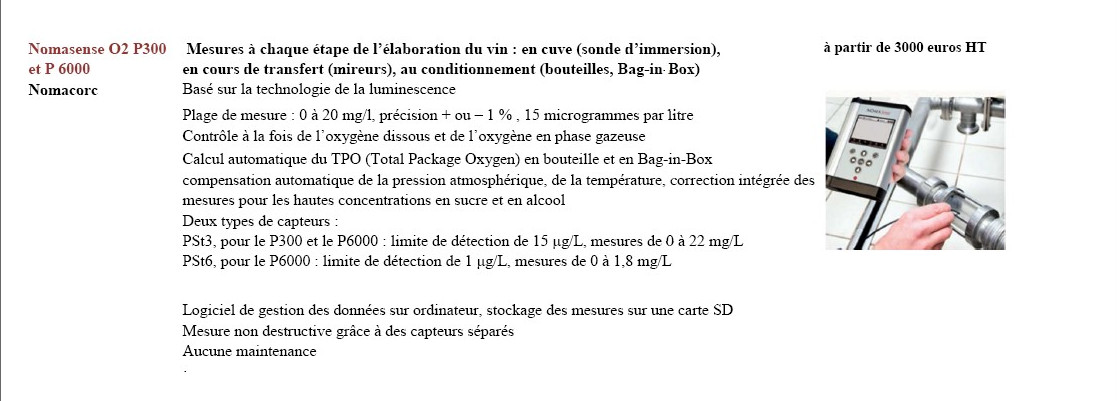


Consultez aussi Tous les articles


Tirage des bois : Faut-il passer au mécanique ?
Depuis deux campagnes, les tireuses de bois cherchent à séduire les vignerons. Si les constructeurs mettent en avant des gains de temps et de rentabilité, le succès semble avant tout résider dans la capacité des vignerons à s’adapter à ces équipements, par un bon palissage et une taille adéquate !
Ces deux dernières campagnes, les démonstrations en Val-de-Loire de tireuses mécaniques de bois suscitent l’intérêt, mais l’achat de machines par les vignerons reste encore anecdotique. Si Kirogn et Clemens travaillent sur le sujet, les principaux constructeurs restent Provitis et Ero, avec pour l’heure 18 exemplaires de la VSE 430 de Provitis, vendus en France (25 000 euros pour le module tirage de bois + 5 000 euros de mâts), et seulement 3 Viteco d’Ero (40 000 euros + 5 000 euros de centrale hydraulique). « À sept vignerons de la Cuma des Ceps Bouillé-Loretz dans les Deux-Sèvres, nous avons commandé une tireuse Provitis, pour 70 ha engagés, reçue en mars 2014, explique Sébastien Prudhomme, également directeur de l’exploitation viticole au Lycée Edgard Pisani de Montreuil-Bellay. L’objectif était de gagner du temps sur les travaux en hiver et diminuer le coût de production. En évitant un pré-taillage et en broyant les bois, cette machine vous fait gagner un passage. »
Gain de temps
En 2013, des essais menés par la Chambre d’agriculture des Charentes montraient ainsi des durées de chantiers moindres pour les tireuses mécaniques, à 25,6 h/ha pour Provitis et 25,5 h/ha pour Ero (taille et broyage compris), contre 38,7 h/ha en manuel et 32,9 h/ha en pré-taillage et tirage manuel, où il faut ajouter le temps de broyage. Au final, les coûts de tirage de bois selon cette étude sont de 320 euros/ha en manuel et 222 euros/ha avec pré-taillage, 180 euros/ha pour la Provitis, et 150 euros/ha pour Ero, rappelle Jean-Yves Dézé, vigneron saumurois à l’origine de la tireuse Provitis. Côté inconvénients, outre les 3 h/ha supplémentaires pour les finissions manuelles après passage des machines, la Viteco provoque des casses de fils régulières, liées aux tensions sur les fils, et demande des piquets de tête bien ancrés. La Provitis nécessite quant à elle l’orientation des sarments du côté du passage de la machine, pour éviter les blocages. « Si la machine fonctionne bien sur nos vignes conduites en baquette, il y a eu quelques difficultés d’utilisation ces deux dernières campagnes, liées aux fils montés sur tendeurs qui ne supportaient par le tirage, et des bois de taille encore trop nombreux après le passage de la machine, souligne Sébastien Prudhomme. Quant à la mise des sarments du côté de passage de la machine, il conviendrait plutôt de baisser le fil de baguette sous le bras des souches, pour obtenir un bon tirage sans préparation supplémentaire. »
Quelques adaptations nécessaires
Des améliorations sont apportées à la Provitis, précise Jean-Yves Dézé, comme la mise en place de diabolos pour soulever les fils releveurs, et la modification du capot pour une faciliter la sortie des sarments. Thomas Junk, commercial Ero, reconnaît que la Provitis garde une longueur d’avance en Val-de-Loire, et que la Viteco vise prioritairement les vignes avec de plus grosses quantités de bois, comme en Charentes ou dans le Gers. Bien que la Cuma des Ceps ait choisi de se séparer de sa tireuse de bois, suite aux complications techniques, Sébastien Prudhomme souligne l’importance du tirage mécanique des bois, pour rester compétitif dans les coûts de production et limiter la pénibilité du tirage des bois. Une tireuse Provitis va d’ailleurs être acquise par la Cuma de Méron, à laquelle adhère le Lycée de Montreuil-Bellay.
Consultez aussi Tous les articles


Capsule à vis, un choix commercial plus que technique
Entre le bouchon en liège et la capsule à vis, la question continue de faire débat, notamment en Val-de-Loire. Le choix correspond davantage à des attentes d’image et de marché, qu’à des enjeux œnologiques ou économiques. Témoignages.
Simple d’utilisation, car pratique à ouvrir et à refermer, la capsule à vis n’a pourtant pas su s’imposer en France. À l’export, son emploi est mieux accepté. « Nous faisons majoritairement des bouteilles avec capsules à vis pour nos marchés en Angleterre et Pays-Bas. La Belgique reste attachée à l’aspect traditionnel du bouchon », note Frédéric Moreau, œnologue aux Caves de la Loire. Sur les 12 millions de bouteilles produites chaque année par la coopérative, 2 millions sont fermées par des capsules, en grande majorité pour l’export. Une proportion plutôt stable dans le temps. « En France, la capsule reste associée à une image de vin d’entrée de gamme. Elle s’adapte mieux aux vins blancs et rosés à rotation rapide qu’à des rouges de garde ! », complète l’œnologue.
Bouchon ou capsule pas de différence au niveau technique
Sur la ligne d’embouteillage de Brissac Quincé, la boucheuse à capsule côtoie celle à bouchon. « Il n’y a aucune différence de prix ou de débit de chantier, note Jacqueline Thomas, responsable du conditionnement aux Caves de la Loire. L’avantage des capsules à vis et de n’avoir qu’un bac à recharger, contre deux pour les bouchons complétés des capsules en alu. ». Entre capsule à vis ou bouchon, la différence ne se joue pas au niveau technique, affirme Frédéric Moreau. « Si vous gérez correctement l’air de l’espace de tête plus important en système capsule, vous avez peu de différence sur l’évolution du produit pour une rotation rapide. Au niveau technique, je ne vois pas d’inconvénient. Le choix se fait essentiellement selon les circuits de distribution. Nous proposons ainsi notre rosé Caprice d’Inès en capsule ou bouchon, selon les demandes de nos acheteurs ! Pour ce produit jeune et féminin, la capsule a d’ailleurs de vrais intérêts. » Même constat chez Villebois. Pour la maison spécialisée dans l’élaboration de Sauvignon blanc du Val de Loire, 100 % des 500 000 bouteilles produites annuellement sont à capsule. « Nous avons fait ce choix en 2004, en raison de notre spécialisation sur les marchés export, explique Thierry Merlet, directeur de Villebois. Pour lui, ce type d’obturateur est bien adapté aux vins blancs secs à consommation rapide du Val de Loire. « Pour la tenue dans le temps et la qualité de nos vins, la capsule à vis nous a semblé être une bonne solution. C’est un obturateur précis pour maîtriser les évolutions du vin. »
Etre équipé d’un système d’inertage
« Le plus important pour obtenir une bonne conservation en capsule à vis est d’être équipé d’un système d’inertage de la capsule et du dégarni du col de la bouteille, où l’envoi d’azote au moment de l’obturation permet de chasser l’oxygène présent, insiste Frédéric Moreau. Si vous êtes déjà équipé d’un générateur d’azote, il vous faudra simplement amener le réseau jusqu’à l’étape suivant le remplissage. Sinon, vous devrez installer l’équipement complet avec les injecteurs. » Quant au choix des joins de capsules, il devra être fait selon le niveau de perméabilité à l’oxygène attendu, entre joins Saranex ou Saran. « Il faut aussi vérifier le bon niveau de fermeture. Le pas de vis et la taille de capsule doivent bien concorder pour limiter les entrées d’air. De petits écarts pourraient être préjudiciables », ajoute l’œnologue. « Il n’y a pas de règle d’or en matière de conditionnement, entre bouchon ou capsule, conclut le directeur de Villebois. Le choix reste personnel, en réponse aux demandes de ses marchés. »









